Vous avez déjà vu comment c’est écrit, une chanson ? Ou pire encore, un manuscrit ? Il y a des trucs soulignés, des mots avec des voyelles qui se répètent trois fois, des tirets au milieu des mots… bref, on n’y comprend rien !
Peuvent pas écrire comme nous, les auteurs ?
Ben non : c’est plutôt nous qui devons apprendre à écrire comme eux !
Allez, je vous donne les règles simples qui vont transformer votre écriture standard en véritable partition de mots.
La chanson : une écriture spécifique
En guise d’introduction, un bref retour sur les 3 types de langue, et les 3 types d’écriture.
1. La littérature (c’est pas nous)
C’est de la pure langue écrite : si la ponctuation standard est bien là, aucun signe de prononciation n’y a sa place.
2. La poésie (toujours pas nous !)
Elle est destinée à être dite à l’oral. Mais comme elle respecte des codes de prononciation très précis (pour les « e muets » notamment, mais aussi pour la diérèse dont je parle plus loin) il n’y a pas besoin de notifier la diction, à part quelques exceptions comme le fameux « encor » qui perd son « e » final à l’écrit. Donc jusque-là, tout va bien !
3. La chanson (c’est nous !)
La chanson enfin, c’est de la langue parlée. Et là, ça se corse !
On va appliquer les règles tacites de l’usage courant en lieu et place de s règles de la poésie classique.
Mais ce n’est pas tout : on va en plus combiner cela aux contraintes de la musique.
Comme les règles de cet art vivant sont fluctuantes, il va falloir baliser un peu tout ça !
Pour tout savoir…
…sur ce sujet, allez donc lire cet article : https://academiedelachanson.fr/chanson-poesie-litterature-la-grande-confusion/
Mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd’hui :
Les 4 codes à connaître
1. La ponctuation standard
Là, c’est simple : virgule, point, point-virgule…
Dans notre texte, tout cela disparaît !
Contrairement à la poésie, où c’est la ponctuation qui dicte le rythme, la diction, et le sens, en chanson, c’est la musique qui fait ce travail.
Et la ponctuation « standard » n’aurait d’autre effet que de brouiller les pistes, puisqu’on la voit mais on ne l’entend pas.
Exit donc !
2. L’élision et son apostrophe
Ça, c’est le code principal.
Pour faire court, une élision c’est quand on fait sauter un « e muet ».
Soit entre deux mots : « comm’ça » (2 syllabes) au lieu de « commE-ça » (3 syllabes)
Soit à l’intérieur d’un mot : « douc’ment » (2 syllabes) au lieu de « doucEment » (3 syllabes).
Comme dans « Le Bagad de Lann Bihoué » de Alain Souchon. à 1:00.
A l’écrit, vous l’avez déjà compris, on remplace la syllabe escamotée par une apostrophe.
Autrement dit, on écrit de façon phonétique.
Et n’allez pas croire comme vous le diront certains que c’est une pratique désuète. Non : tous les auteurs font comm’ça : c’est la seule façon « musicale » d’écrire !
Pour tout savoir sur le « e muet », je vous invite à aller lire ici l’article consacré à ce sujet : https://academiedelachanson.fr/e-muet-en-chanson/
3. La diérèse et la synérèse
Kézako, me direz-vous avec à-propos.
Question pertinente, vous rétorquerai-je aussi sec !
Voici la réponse :
La diérèse
La diérèse, c’est quand on dédouble un groupe vocalique en deux syllabes.
Un exemple ?
La poésie classique en est (hélas) truffée : de Verlaine avec « les sanglots longs des vi-olons » à Baudelaire « en se réfugi-ant dans l’opi-um immense », on a droit par défaut à cette figure un peu lourde.
D’une façon plus rigolote, le géni-al Ray Ventura l’utilise dans « A la mi-août ». J’adore !
Et à l’écrit, alors ?
En chanson, on marque la di-érèse par un tiret. Pas de tiret, pas de diérèse !
La synérèse
On s’en doutait un peu, mais la synérèse, c’est l’inverse : c’est quand on prononce deux voyelles contiguës d’un même mot en une seule syllabe.
France Gall nous en offre deux d’un coup dans « Il jouait du piano debout » à 0 :46
Le mot « Jou-ait » (qui compte normalement 2 syllabes) est dit d’un trait (1 syllabe).
Et le mot « pi-a-no » (qui compte normalement 3 syllabes) prononcé « pia-no » (2 syllabes).
S’il n’existe pas de marquage officiel pour la synérèse, beaucoup d’auteurs utilisent comme je le fais moi-même le signe musical de liaison : « il jou͜ait du pi͜ano debout ».
On peut même utiliser ce signe entre deux mots :
« Le chat qui͜ est à côté » (synérèse en 6 syllabes)
ne sonnera pas comme « Le chat qu’est à côté » (élision en 6 syllabes)
ni comme « Le chat qui est à côté » (prononciation classique en 7 syllabes)
4. La syllabe tenue
Qui peut oublier l’acouphénoménal « je t’aime » de Lara Fabian (qui nous laisse quand même 1:54 pour nous mettre aux abris).
Elle y tient son mythique « aime » durant plusieurs secondes, et sur deux notes. Les plus courageux d’entre vous peuvent aller vérifier, mais ne venez pas vous plaindre après !
A l’écrit (ouf!) comment transcrire ce refrain pour faire ressortir cet effet, et savoir le relire ensuite ?
Pour marquer simplement la durée, deux codes sont possibles :
– Multiplier la dernière voyelle : « Je t’aiiiiime »
– Mettre un tiret long : « Je t’ai ̶ me »
Et pour marquer les deux notes distinctes du « ai » on combine les deux codes : « Je t’ai-aime ».
La règle du jeu
1. Pour une déclaration SACEM
Les paroles doivent être déclarées à la SACEM « dans leur forme intégrale ».
Le texte déposé doit donc refléter fidèlement la version chantée, car c’est cette version qui sera protégée et laquelle seront calculés les droits et réparties les redevances.
Dans les faits, si la ponctuation « standard » disparait, seules les élisions, (donc les apostrophes) seront reportées telles que vous les écrivez pour l’interprétation ou la partition finale.
2. Pour collaborer avec des musiciens
Entre pairs, il convient de parler le même langage et de faire preuve d’un maximum de clarté. Et là, c’est le bon sens qui est la règle :
– Pour un interprète, un choriste ou un compositeur, vous vous devez de fournir un maximum de précisons. Le texte codé s’impose.
– Pour un metteur en scène ou un technicien, donnez une version simple, sans aucun codage qui lui compliquerait la tâche.
3. Pour le livret du CD
Là, c’est simple !
L’auditeur final n’est pas un spécialiste, et il n’a pas vocation à décrypter vos notes techniques !
On adopte donc, par respect pour lui, une écriture plus « lisible », en version orthographique standard avec ponctuation, même si elle est moins fidèle au rendu vocal.
A la marge, on peut éventuellement conserver les apostrophes pour les élisions si cela aide à restituer la version chantée.
En conclusion :
Écrire une chanson, c’est plus qu’écrire un simple texte : c’est jongler entre sens, sonorité et structure.
Au moment de coder tout cela, on n’est pas encore dans la partition musicale, mais on s’en rapproche. Et ces petits codes sont là pour servir la musique, alléger la lecture, et surtout clarifier l’intention.
Vous avez désormais tous les repères pour coder au mieux votre texte selon celui à qui il est destiné.
Codons, décodons, et
Viv’ la chansooon !
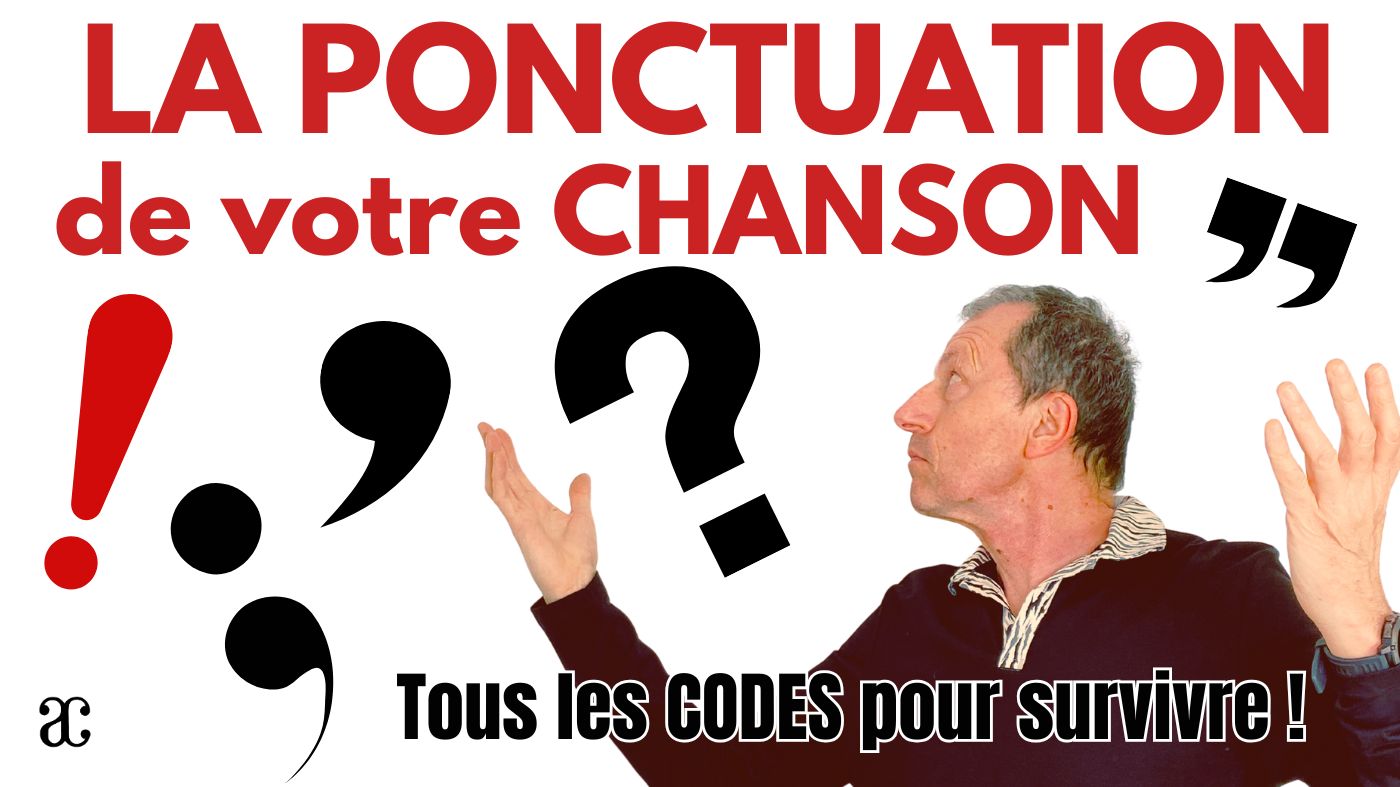
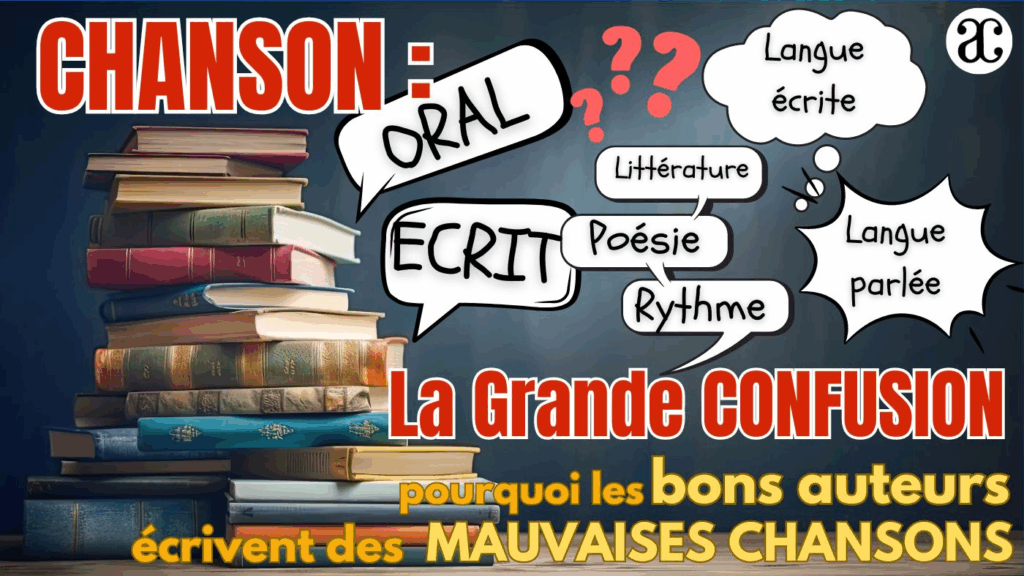
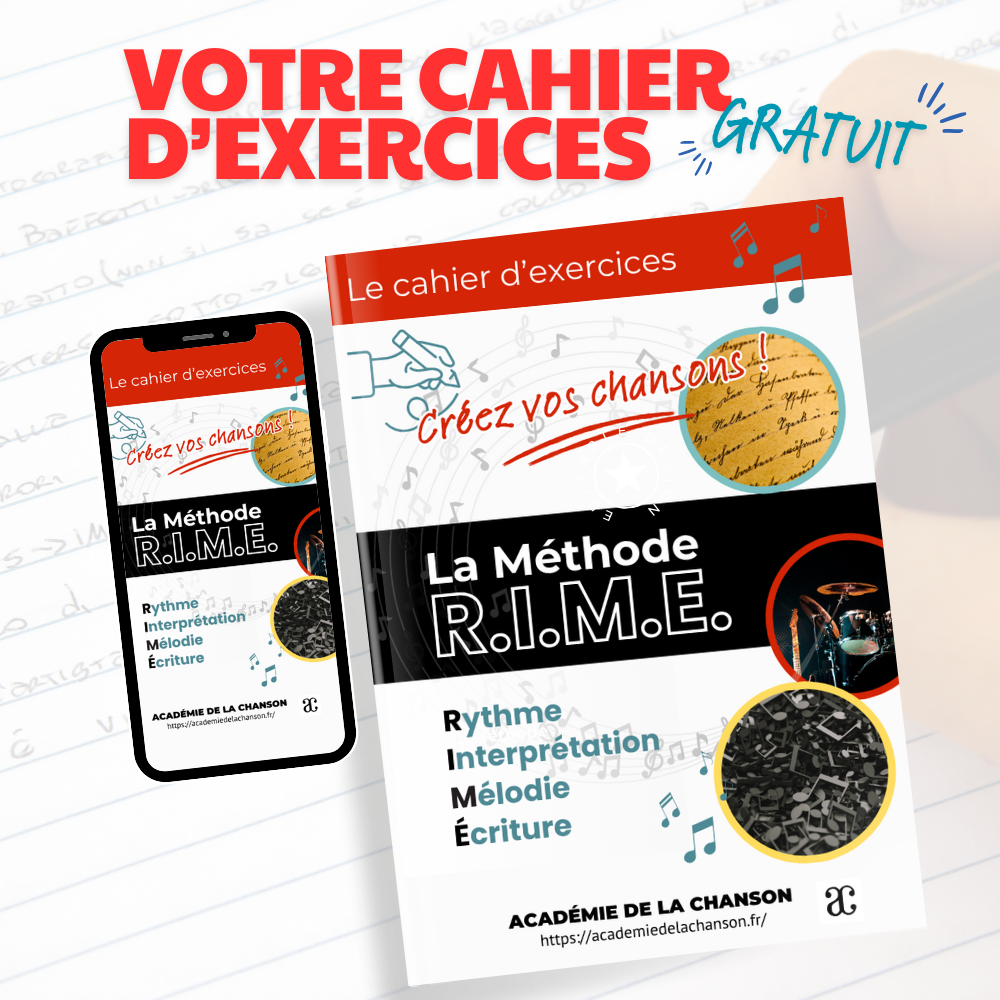

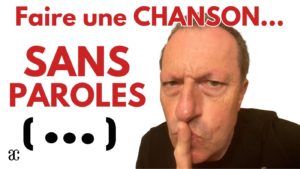
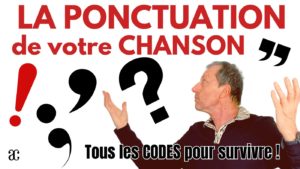
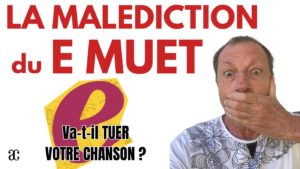
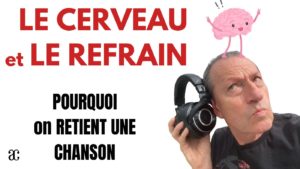

C’est un sujet peu évoqué et pourtant important, surtout lorsqu’on envisage d’avoir des choristes !
Merci pour tous ces détails claires et utiles!
Merci Sylvie d’avoir pensé à mentionner les choristes ! je n’y avais pas pensé dans la première version de l’article ! Voilà qui est complété ! 🙂
C’est fou de voir à quel point écrire une chanson demande autant de précision et de subtilité. Merci pour cet éclairage, c’est super bien expliqué et ça donne envie d’en apprendre plus sur cet art !
Merci Edouard. En fait, ces codages sont des outils de travail, comme les signes de « ponctuation musicale » que l’on trouve sur les partitions, avec les bends, les trilles ou les trémolos. Les notes elles-mêmes ne suffisent pas toujours.
En voilà un article qui fait gagner un temps fou pour enregistrer en studio ou communiquer avec des pairs ! Je ne savais pas qu’on pouvait/devait coder les textes, et je découvre cette merveilleuse chanson de Renaud : merci pour tout ça !
Merci Eva ! Oui, les textes peuvent se coder, mais doivent rester lisibles. Certains musiciens préfèrent coder eux-mêmes les textes qu’on leur donne, ce qui ne manque pas de leur poser des tas de problèmes en cas de modification ou de mise à jour, car ils doivent tout refaire ! 😀