Si vous êtes comme moi, quand on vous parle de rimes masculines et de rimes féminines :
1) vous ne voyez pas à quoi ça sert
2) en fait vous ne savez même pas ce que c’est
3) vous ne comprenez rien quand on essaie de vous expliquer
Et en plus vous vous sentez bête parce que ça a l’air important !
Alors, fini le temps du malaise face aux experts, je vais tout vous expliquer de façon simple, et promis, en moins de temps qu’il n’en faut pour changer de genre, vous aurez tout compris !
Circulez, y’a rien à voir !
La première chose à savoir, c’est qu’en terme de genre (masculin/féminin), les rimes n’ont aucun rapport avec le genre du mot.
Allez, je fais mon petit malin juste histoire de frimer ?
Regardez cette maison.
« La maison » est un mot féminin avec une rime masculine.
« La porte », tout comme « Les fenêtres » sont des mots féminins avec des rimes féminines.
« Le paillasson » est un mot masculin avec une rime masculine, tandis que « le garage » est un mot masculin avec une rime féminine.
L’ensemble (rime féminine) aurait besoin d’être rafraîchi (rime masculine)

Bref, ON N’Y COMPREND RIEN !
Allez, j’explique :
La rime féminine
Devinette : à quoi reconnait-on une rime féminine ?
Allez, lancez-vous ! Une rime féminine, ça finit par..?
– Euuuh…
Oui ! Bonne réponse ! Ça finit par « E » !
Donc si on voit un « e » à la fin du mot, c’est une rime féminine.
C’est tout.

Peu importe le genre du mot : Il y a un « e » à la fin (ou « es » au pluriel) ?
Eh bien c’est une rime féminine !
NEXT !
La rime masculine
Ben… Et les rimes masculines, alors ?
Les rimes masculines, c’est toutes les autres !
Peu importe qu’elles finissent par une consonne ou une voyelle, que le mot soit masculin ou féminin, ou même qu’il s’agisse d’un mot « agenre » comme un verbe, ou une interjection, s’il n’y a pas de « e » à la fin (ou « es » si c’est au pluriel), c’est « rime masculine ».
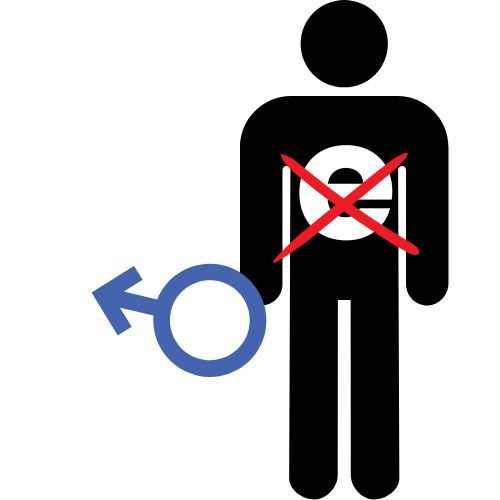
Et c’est tout !
A quoi ça sert ?
Bon, à ce stade de l’article, déjà vous êtes sauvés : vous ne ferez plus « mauvais genre » dans les soirées mondaines.
Ça, c’est fait !
Si vous voulez, vous pouvez arrêter la lecture ici.
Mais si vous voulez en savoir plus, restez avec nous.
Car c’est ici qu’arrive notre invité surprise : le « e muet » et son grand pote : l’accent tonique, !
La clé de l’énigme : le « e » muet
Le « e », c’est lui le responsable de la rime féminine,
Pourquoi ?
Eh bien, revenons à notre maison :
vous ne dites pas « la portEU et la fenêtrEU »
A l’oral, on va dire « la port’ et la fenêtr’ ».
Bon ben voilà : c’est pour cela que les « e » sont dits « muets » : ils ne s’entendent pas.
Pour tout savoir sur le « e muet », vous pouvez aller lire l’article « La malédiction du « e muet » .
En poésie, on a donné aux vers qui terminent par le « e muet » le nom de rimes « féminines » : parce qu’il y a un « e », comme un féminin.
Et « du coup », toutes les autres sont… « masculines » ! Logique !
Sur le plan grammatical, c’est débile, mais sur le plan mnémotechnique, ça marche.
Je répète : à quoi ça sert ?
Oui, oui, voilà, j’y viens !
En poésie classique, on faisait volontiers alterner rimes masculines et rimes féminines.
Cela favorisait le flow !
Oui mais : la poésie, c’est de la langue orale !
Et nous, on fait de la chanson ! Et en chanson,
– d’une part on pratique la langue parlée
– d’autre part c’est souvent la musique qui va nous dicter instinctivement le type de rime.
Alors, toutes les règles comme rime pauvre, suffisante, riche, genre et compagnie, et bien comme dit Emmet Brown dans Retour vers le futur…
« On s’en tape ! »
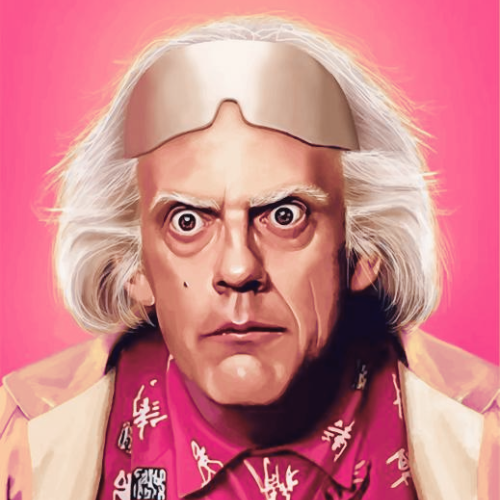
Elle est pas belle, la vie ?
Pour jouer les experts
Allez, une exception
Ah, je m’aperçois que quelques experts ont sauté au plafond face à mon explication iconoclaste et un peu simplificatrice (mais pas simpliste, hein !).
Il y a effectivement quelques exceptions, que je n’ai pas mentionnées, car elles relèvent du bon sens.
« elles relèvent », tiens justement en voilà une, d’exception : c’est le « ent » final de « elles relèvent ». On ne dit pas « elles relèvEU ». Une sorte de « ent » muet !
A l’inverse, il y a des cas où le « e » n’est pas muet : comme dans « tE », « mE », « sE », etc.

Vous en conviendrez : là on chipote.
Parce que quand on a compris le principe (ce qui est votre cas si vous avez bien lu), ça tombe sous le sens.
Les explications qui ne riment à rien
J’espère que mon explication était claire.
Sinon, juste histoire de rire un peu, je vous renvoie vers la définition de Wikipédia des rimes masculines et féminines. Et pourtant : c’est la plus claire que j’ai pu trouver !
Attachez vos ceintures !
« Une rime est dite :
– féminine lorsque le dernier phonème est un e caduc (nommé autrefois « e féminin ») ; ainsi, les deux fins de vers suivantes ont des rimes féminines : […] abolie, […] Mélancolie
→ Rime féminine /ɔliə/.
Le e caduc forme une rime féminine même après voyelle, ainsi que devant -s . En revanche, ce n’est pas le cas dans les subjonctifs non plus que dans les imparfaits et conditionnels en -aient – -oient dans l’orthographe classique, en raison de l’évolution phonétique. En effet, dans ces cas précis, le e final a cessé d’être prononcé plus vite que dans les autres cas du type prient.
– masculine dans les autres cas : […] inconsolé, […] constellé
→ Rime masculine /le/. »
C’est clair’Euh, non ?
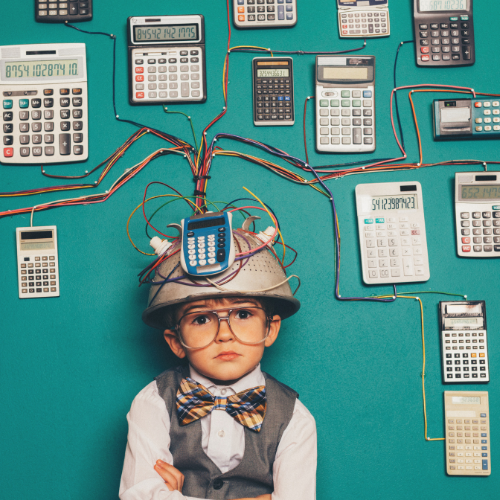
Pour finir avec un sourire, je vous propose deux nouveaux genres de rimes qu’on ne trouve pas encore dans les dictionnaires.
D’autres genres de rimes
Il faut vivre avec son époque :
Je vous présente en avant-première deux nouveaux genres de rimes.
La rime transgenre
Certains chanteurs réinventent l’orthographe en nous gratifiant désormais de rimes transgenre !
Claudio Capéo (on ne s’en lasse pas !) transforme son fils, non pas en fille, mais en « fils.e » à 0:58
Et la rime masculine devient féminine !
Si la chanson est « Riche »,
la rime, elle, ne l’est guère !
L’écriture inclusive s’empare de la chanson !
La rime agenre
Cette fois c’est du côté de la légion étrangère qu’il faut se tourner !
Finie la gégène ! Désormais on coupe la langue !
Avec leurs fins de phrases coupées, les chants de légionnaires ont un phrasé assez inattendu, et instantanément identifiable.
Et du coup, on ne sait plus s’il s’agit de masculin ou de féminin.
Des rimes agenres, quoi !
Bon, j’ai l’air de me moquer comme ça, mais en fait j’adore !
Conclusion :
Si Claudio Capeo a les moyens de faire parler les » e muets « ,
dans la légion, y’a rien qui dépasse !
A vous de jouer !
Une fois n’est pas coutume : je vous propose un petit travail d’écoute
Vous connaissez « Chanson de pirates » de Claude Nougaro ?
Je vous l’ai mise juste en dessous.
Je vous propose de l’écouter.
Ecoutez notamment les paroles (elles sont magnifiques), et notez vos remarques :

1) Je vous demande d’observer comment sont organisées les rimes masculines et féminines : que remarquez-vous ?
Notez-le en commentaire .
2) Vous avez dû remarquer que cette organisation de rimes donne un côté « classique » à cette chanson.
Et c’est normal.
Car l’auteur n’est pas Claude Nougaro. Alors qui ?
Si vous l’avez découvert, notez-le en commentaire
Enfin, la diction donne beaucoup de puissance au propos.
Mais d’ailleurs, d’où vient cet accent ?
Si vous connaissez la région et la ville d’origine de Nougaro, écrivez-le en commentaire.
Notez vos impressions en commentaire !
Allez-y sans crainte : masculin.e.s ou féminin.e.s, on est entre ami.e.s !
En conclusion
POUR RESUMER : Un « e » : féminin / pas de « e » : masculin.
Même si l’alternance des rimes féminines et masculines, aujourd’hui, c’est fini, il est bon d’avoir en tête la musique spécifique des différents types de rimes, et le balancement particulier que chacune porte.
La chanson (nom féminin à rime masculine) est un art délicat, et les mots sont notre palette. Sachons en utiliser toutes les subtilités !
Vive le Féminin, Vive le Masculin, et
Vive la Chanson !

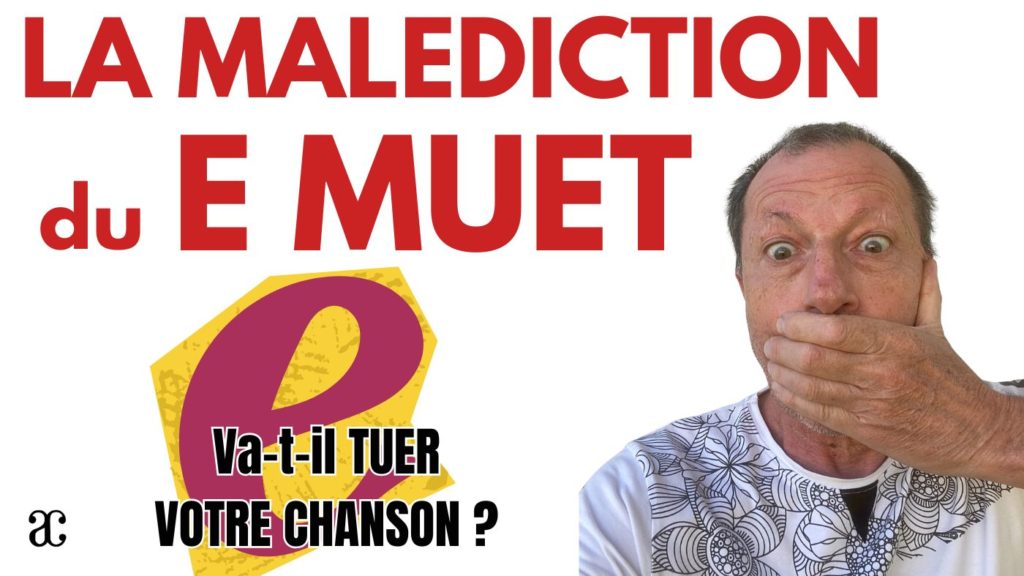
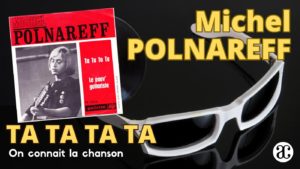

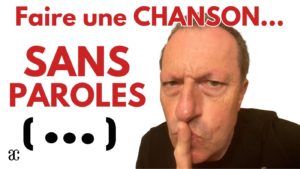
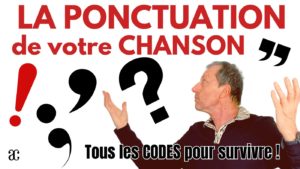
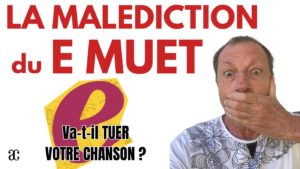
Merci pour cette explication claire et pleine d’humour 😀
J’ai enfin compris la différence entre rimes masculines et féminines, et surtout pourquoi ça peut compter dans l’écriture d’une chanson.
Merci Edouard pour ton retour. J’ai moi-même énormément mis de temps à comprendre de quoi il s’agissait lorsqu’on parlait de rimes masculines ou féminines… et quand j’ai enfin compris, je me suis dit : « Quoi, c’est tout ? » 😀
Merci pour l’exercice sur Nougaro! Effectivement on voit bien le plaisir qu’il a à jouer avec les mots, les rimes comme an/ane/em, aire/ère/erre/eure/eur, capitan/capitane… Et bien sûr en chargeant la fin des mots pour authentifier de ses origines du sud!!
Merci Sylvie pour ton analyse ! Tu as fait cela avec beaucoup de sérieux, ouah ! Dans cette chanson, Nougaro n’est que l’interprète, puisque l’on doit ce texte magnifique à Victor Hugo.
Tu as bien raison – et tu m’as bien fait rire encore une fois ! C’est la sonorité des mots qui compte en poésie, et pas la façon dont ils s’écrivent. Quand je pense aux analyses perchées qu’on nous a fait écrire sur l’enchaînement des rimes féminines dans le sonnet « les Voyelles »… un poème vivant qu’on disséquait pied par pied, au lieu d’en écouter toute la richesse.
Merci pour cette nouvelle étape dans le pays des rimes.
Ouah ! Le sonnet « Les voyelles » ! Quel cauchemar ! Et selon moi quel mauvais texte ! Je compatis, mais grâce à des gens comme toi qui vulgarisent VRAIMENT la culture, cette approche pesante (et souvent hors-sujet) appartiendra bientôt au passé !
Tu as su rendre un sujet technique — les rimes masculines et féminines — vivant et accessible. J’ai aimé cette idée soulignée : « l’alternance des rimes féminines et masculines, aujourd’hui, c’est fini », tout en nous incitant à « avoir en tête la musique spécifique des différents types de rimes ». C’est à la fois libérateur et inspirant pour qui compose ou écrit. Bravo pour cette invitation à jouer avec les mots en musique 😉
Merci Rémi. Ce qui compte finalement, c’est que ça sonne à l’arrivée. Tout simplement ! 🙂